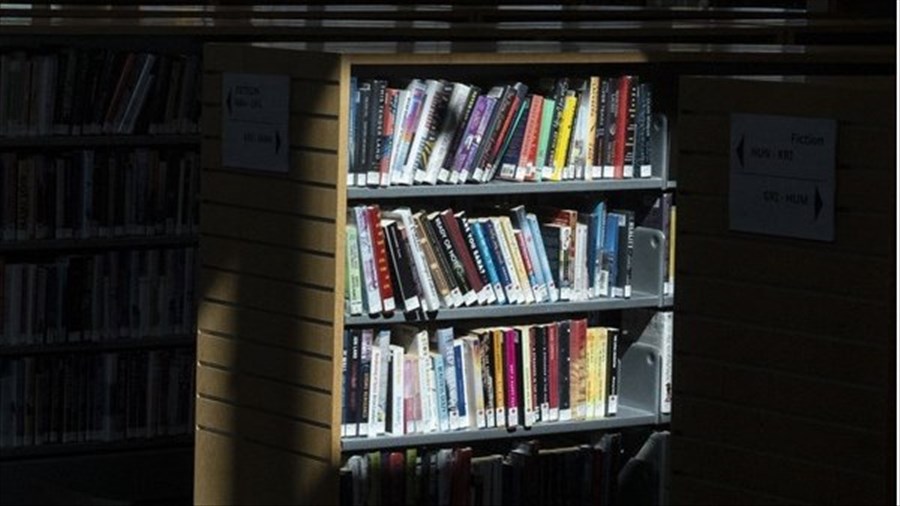Louer un banc d’église, partie II
La location de bancs dans l’église constituait la principale source de revenus d’une fabrique. En 1698, une ordonnance synodale précisait déjà : « La pauvreté des paroisses de la campagne venant, en partie, de ce que les marguilliers n’ont pas de soin de travailler à lui faire un revenu certain, en mettant des bancs d’une juste grandeur dans chaque église ou en les accordant à un prix trop bas; Nous ordonnons que dans les églises où il n’y aura point encore de bancs, les marguilliers en fassent faire, et les fassent ensuite crier à la porte de l’église, pour les accorder à ceux qui en feront le plus grand avantage de l’église; ce qui se pratiquera toutes les fois que ceux à qui lesdits bancs auront été accordés mourront. » (Rousseau, p. 98)
Donc, les bancs se louaient publiquement et étaient concédés au plus offrant. Le montant de l’enchère représentait le montant de la rente annuelle et la location était à vie, à condition que la rente soit toujours payée à temps.
La fabrique Saint-Pierre de Sorel procédait pratiquement de la même façon afin de financer la paroisse. Par contre, malgré l’ordonnance synodale de 1698, les habitants du bas Richelieu au XVIIIe siècle étaient peu intéressés à augmenter les locations par enchères et savaient très bien que les meilleurs bancs seraient remportés par les plus riches.
Par conséquent, ils utilisaient les petits pouvoirs qu’ils pouvaient posséder auprès de la fabrique pour éviter l’application de la règle des enchères. Les bancs se louaient donc à taux fixe, situé habituellement à trois livres par années. Ce n’est qu’à partir du début du XIXe siècle qu’une véritable concurrence avec enchères s’établit.
Lors des enchères tenues à Sorel entre 1809 et 1819, on a adjugé des loyers annuels de 1,5 à 76 livres. Comme la location des bancs était une source de revenus importante pour la fabrique, celle-ci remplissait des registres de réservation où l’on peut retrouver la liste des locataires des bancs classés par ordre alphabétique, le numéro du banc réservé et le prix payé. Un banc devenait vacant lors du décès du locataire ou encore par défaut de paiement à l’échéance fixée.
Aujourd’hui, la location de bancs d’église ne se fait plus, mais il y a encore, dans certaines églises, des plaques avec noms des familles propriétaires des bancs. Une trace de cette ancienne pratique dans notre culture! En 1836, après avoir fait partie du Diocèse de Québec durant près de 114 ans, la paroisse Saint-Pierre de Sorel a été intégrée au Diocèse de Montréal jusqu'en 1852, lors de la création du Diocèse de Saint-Hyacinthe. Elle en est d'ailleurs la plus ancienne paroisse et l'une des plus vieilles du Canada.
Visitez la page Facebook de Société historique Pierre-de-Saurel.
Sources : GREER Alan. Habitants, marchands et seigneurs : La société rurale du bas Richelieu 1740-1840, Septentrion, 2000, 358 p. http://bit.ly/12Mvfln
ROUSSEAU Louis. Atlas historique des pratiques religieuses : Le Sud-ouest du Québec au XIXe siècle, Presses Université d’Ottawa, 1998, 250 p. http://bit.ly/ZgvkZP
Société historique Pierre-de-Saurel, P192 – Fonds Fabrique de la paroisse Saint-Pierre de Sorel.
Mylène Bélanger, archiviste en chef à la Société historique Pierre-de-Saurel, www.shps.qc.ca